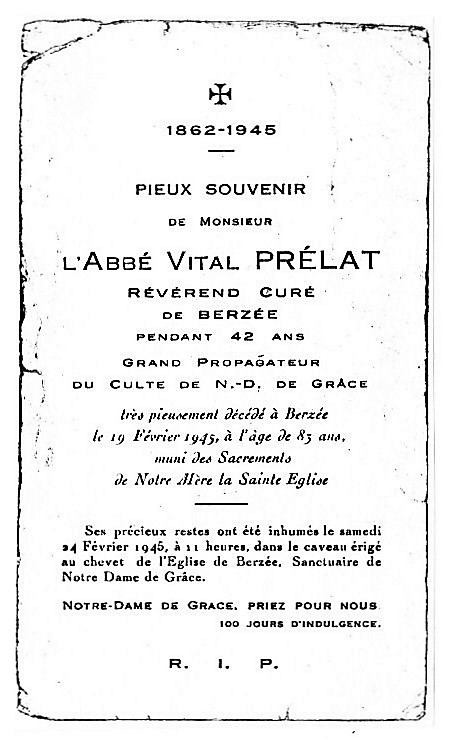La Petite Gazette du 14 juillet 1999
Les jeux d’antan… Le jeu de quilles
C’est Monsieur Emile Van Craywinkel, d’Evelette, qui évoque ses souvenirs pour vous :
« De 1934 au début de 1940, on a pratiqué le jeu de quilles, chez nous, à Libois, où c’était un café. Tous les dimanches après-midi, une vingtaine d’amateurs se réunissaient pour, pendant quelques heures, jouer aux quilles.
Mon père, très attentif à ce jeu, organisait deux concours par année ; il y avait de nombreux lots : vélos, radios, boîtes de cigares, chocolat et divers. Beaucoup de professionnels y assistaient, les mises étaient de 20 francs pour participer à ce jeu.
C’est le plus grand nombre de quilles renversées qui désignait le gagnant, à moins d’un ex aequo, car alors ils devaient à nouveau s’affronter pour la première place et, peut-être, remporter le beau vélo.
Les autres dimanches, c’étaient surtout les habitués de la commune qui venaient. Ces jours-là, les mises variaient de 1 à 5 francs. Quand il y avait un ex aequo, les joueurs perdants devaient mettre un supplément pour continuer la partie. Il arrivait parfois que la somme en jeu soit importante.
C’était moi, se souvient M. Emile Van Craywinkel, qui faisait la relève des quilles. Chaque joueur gagnant me donnant 10% de la somme gagnée ; cela me rapportait assez bien d’argent… 
Le joueur peut faire déplacer trois quilles d’un demi-centimètres ; soit écarter un peu la première, ouvrir légèrement la deuxième, la « fourche », ou la troisième, la « dame ». Cela donne un bon résultat mais cela demande quand même une bonne technique de la part du joueur qui doit encastrer le boulet entre ces trois quilles.»
La Petite Gazette du 8 septembre 1999
Le jeu de quilles
Monsieur Simon André, de neufchâteau, se souvient également :
« La relation de M. Van Craywinkel sur le jeu de quilles m’a aussi rappelé des souvenirs. C’est que, comme lui, j’ai souvent été appelé à relever les quilles après la messe et entre les vêpres et le salut du dimanche. Il est vrai que le jeu était tenu par les habitants de la maison jouxtant la nôtre.
A la lecture, j’ai remarqué que le règlement différait quelque peu, malgré la distance assez courte qui sépare les deux localités, comte tenu des moyens de transport actuels bien entendu.
Chez nous :
– les fourches étaient déplacées au gré du joueur (il n’était pas question de millimètres !) ;
– la dame restait en place ;
– le boulet était seulement percé de trois trous et n’était pas recouvert de tôle métallique percé.
Personnellement, j’ai connu trois jeux de quilles différents :
- En cendrée : la poutrelle était remplacée par des cendres de charbon. Un bout de poutrelle existait au début du jeu et devait être touchée par le boulet lors du lancement.
- Le même que celui représenté par le croquis de Monsieur Van Craywinkel.
- En béton : sur celui-ci il était préférable –et toujours bénéfique- de donner un mouvement de rotation au boulet, de façon à ce qu’il arrive dans les quilles en tournant.
Que de fois ai-je entendu : « Hé, m’fi toûne on pô l’prumîre. Droûve li fotche va, nin ciçale, lôte. Li èrin-ne n’èst nin ès-s’plèce ! » avec, en plus, les quolibets lancés à l’adresse du joueur qui manquait de réussite.
Le jeu de quilles était, en somme, le grand amusement hebdomadaire des hommes et des jeunes gens d’alors, toujours, le pèkèt aidant parfois, empreint de bonne humeur.
Avant la dernière guerre, conclut Monsieur André, un jeu en béton existait à Bonsin, chez Georges Dujardin, et un autre à Chardeneux, chez Louis Wathelet.
Madame Bury-Lecron, de Hamoir, m’écrit :
« Il y a chez nous une ancienne piste de jeu de quilles terminées par une pierre de taille bleue, marquée des neuf emplacements de quilles. Bien que la piste ait été refaite en ciment, il reste un vestige, très usé, de la piste en bois.
La maison est très ancienne et, dans le temps, c’était une auberge-café et marchand de charbon, l’écurie qui abritait le cheval existe encore. C’était la maison Grailet-Godfroid. Les personnes vivant à Hamoir depuis longtemps s’en souviennent certainement. »
La Petite Gazette du 15 septembre 1999
Encore le jeu de quilles
Monsieur G. Carlier, d’Andoumont, apporte également une petite précision sur le sujet :
« A Jupille, où j’ai habité trente ans, il y avait, près de la place de Meuse, un café qui possédait une piste de quilles. Le vieil homme qui m’en a parlé me disait que l’on jouait gros jeu et que les joueurs de quilles se reconnaissaient au fait qu’ils entassaient les billets, en vue, dans leur poche. »
La Petite Gazette du 16 juin 2010
LES JEUX DE QUILLES DE NOS VILLAGES
S’il est bien un jeu populaire qui connut un succès et un engouement extraordinaires en nos régions, c’est bien le jeu de quilles. Monsieur René Gabriel, de Roanne-Coo, mène actuellement une recherche sur ce sujet passionnant et, bien sûr, il a besoin de vos souvenirs et de vos connaissances en la matière.
« Je recherche les anciens jeux de quilles présents dans nos villages au siècle passé. J’ai déjà contacté plusieurs de nos aînés et ai recueilli, grâce à eux, des précisions très intéressantes. Des jeux existaient pratiquement dans tous nos villages, ainsi on en a retrouvé quatre à Rahier, à des époques différentes. Mon inventaire s’étoffe mais ne demande qu’à se compléter encore.
Je me suis rendu au Musée de la Vie Wallonne, où j’ai été très bien reçu et où j’ai pu découvrir des photographies généralement prises entre 1890 et 1930. Je possède maintenant une vingtaine de reproductions localisées. Parmi celles-ci, une photographie me pose un problème de localisation et j’espère que les lecteurs de La Petite Gazette pourront m’aider. Le document ci-dessous porte simplement comme indication « 1910. Rahier ? La Gleize ? » et je ne suis pas parvenu à situer l’endroit dans une de ces deux localités… Le pourrez-vous ?

Parmi les personnes que j’ai interrogées, plusieurs ont « bill’té » (N.D.L.R. Ailleurs, on aurait dit « bèyeter ou biyeter ») lorsqu’ils étaient jeunes. « Bill’ter » ou « repiquer » signifiait remettre ou redresser les quilles (les bèyes). Le « bill’teur » recevait une petite rémunération de la part des gagnants, plus ou moins 5% des gains.
Certains de mes contacts m’ont signalé des mises exorbitantes, en période de guerre notamment, se soldant parfois par la perte de bétail… Plus généralement, on jouait pour une tournée, un jambon…
Il est probable que de nombreux lecteurs pourraient nous donner des informations sur ce délassement pratiqué le dimanche, souvent après la messe, et lors des fêtes locales. Pourvu que ces personnes communiquent leurs souvenirs, leurs photos à La Petite Gazette. D’avance, je les en remercie chaleureusement.
J’espère sincèrement que vous répondrez à cet appel en nous communiquant vos souvenirs, vos anecdotes liées à la pratique de ce jeu si populaire jadis en nos contrées. Puissiez-vous nous en décrire le déroulement précis, combien de joueurs ? Durée d’une partie ? Règles et usages à respecter ? Noms des différents gestes spécifiques ? Rôles de chacun ? Qui prenait et conservait les mises ?… Bref tout ce qui touche à l’organisation même d’une partie, mais aussi les lieux où étaient installés ces jeux (à l’extérieur, à l’intérieur), les moments auxquels on y jouait… Les anecdotes liées aux mises et aux prix et le pourquoi de la disparition de ce jeu nous intéressent tout autant. Merci de nous communiquer tout ce que vous savez sur le sujet, cela devrait nous valoir des récits savoureux à présenter prochainement dans cette page…
La Petite Gazette du 23 juin 2010
LES JEUX DE QUILLES DE NOS REGIONS
Madame Marie Deselliers, de Qualité-Village-Wallonie, n’est certes pas une inconnue pour les lecteurs attentifs que vous êtes. Avec son intervention de ce jour, elle nous montre qu’elle peut tout aussi bien répondre aux appels lancés qu’en susciter d’autres…
« Concernant les jeux de quilles, m’écrit-elle, il y en a encore un dans le village de Géromont (Comblain-au-Pont) avec sa rampe en bois et ses quilles en bois. Ils le sortent encore lors de certaines fêtes de village.
Il y en avait également un à la salle d’Awan (Aywaille), on le voit sur de vieilles photos. (N.D.L.R. Quelqu’un nous permettra-t-il de les présenter aux lecteurs de la Petite Gazette ? D’avance, je remercie cette personne) »
Monsieur D. Montanus a lui aussi réagi rapidement à l’appel lancé par M. Gabriel.
« J’espère, m’écrit-il, que M. GABRIEL appréciera la photo en annexe. Ce jeu se situait à l’entrée du village de Humain, devant un établissement faisant tout et ce en 1912. L’établissement est devenu un immeuble de logements et des transformations de voirie ont changé les lieux.
Fortement envahi par la végétation actuellement, à côté de la salle du village dans les années 50 un « boulodrome » avait été installé et a fonctionné jusque les années 90, j’ai vu il n’y a pas si longtemps une boule et des quilles dans la cave de cette salle qui doit incessamment être rasée pour faire place à une nouvelle. »
Un très grand merci à mes correspondants. Vous aussi, vous avez certainement des souvenirs liés à ce jeu si populaire jadis en nos villages, j’espère de tout cœur que vous les partagerez avec nous… Puissiez-vous nous en décrire le déroulement précis, combien de joueurs ? Durée d’une partie ? Règles et usages à respecter ? Noms des différents gestes spécifiques ? Rôles de chacun ? Qui prenait et conservait les mises ?… Bref tout ce qui touche à l’organisation même d’une partie, mais aussi les lieux où étaient installés ces jeux (à l’extérieur, à l’intérieur), les moments auxquels on y jouait… Les anecdotes liées aux mises et aux prix et le pourquoi de la disparition de ce jeu nous intéressent tout autant. Merci de nous communiquer tout ce que vous savez sur le sujet, cela devrait nous valoir des récits savoureux à présenter prochainement dans cette page…
La Petite Gazette du 14 juillet 2010
LES QUILLES DE MON ENFANCE…
Madame Maria Lambotte, de Werbomont, est une correspondante fidèle et prolixe, personne ne s’en plaindra, elle ne rate jamais une occasion de partager ses souvenirs avec La Petite Gazette.
« Qui n’a pas reçu, à l’époque, un jeu de quilles pour la Saint-Nicolas ?
Je me souviens avoir accompagné papa après la grand-messe de 10h30, à Ernonheid, au café tenu par Adolphe Bodson (maison qu’habitent aujourd’hui Maurice et Liliane Lahaye). Maman, quant à elle, allait à la messe basse de 8h. à Bosson.
J’étais prise par le sérieux qui entourait les joueurs.
On relevait li dame, li fotche…
Il est vrai que les mises devaient être bien contrôlées pour que tout se passe de façon équitable. Une fois grandis, nous rentrions de la messe, tous à vélo. Papa rentrait bon dernier, maman n’était pas ravie, le dîner traînait. Un dimanche, il est rentré un peu plus tard, un peu trop tard…
Puis, en février 1953, papa offrit à maman, pour ses 40 ans, un gaufrier électrique. Peu après, maman me dit, toute confuse : « Tu sais, le dimanche où j’ai grondé papa, il avait fait une grosse part aux quilles et il avait gardé les sous pour mon anniversaire ! » Ce n’est pas beau cela ? »
La Petite Gazette du 25 août 2010
LE JEU DE QUILLES DE VILLERS-LE-TEMPLE, « E MON DAVIN »
Monsieur A. Mathelot, de Poulseur, a gardé en mémoire quelques souvenirs liés au jeu de quilles installé à Villers-le-Temple è mon Davin. Il a eu l’excellente idée de les partager avec nous tous et, pour la clarté de ses explications, a joint les illustrations suivantes. A ses explications s’ajoutent celles transmises par Monsieur Marcel Grégoire, de Gouvy
 Monsieur Grégoire précise d’emblée que, à sa connaissance, « il existait trois jeux de quilles différents : à 9, à 7 et à 5 quilles. »
Monsieur Grégoire précise d’emblée que, à sa connaissance, « il existait trois jeux de quilles différents : à 9, à 7 et à 5 quilles. »
« Nous étions à la fin de la guerre et j’avais 10 ans, se souvient M. Mathelot. Le jeu était installé derrière la porte cochère visible sur le dessin.
Explication des légendes de ce plan.
- Mur extérieur de la maison.
- Banc réservé aux joueurs (à la hauteur d’un tabouret de bar)
- Deux planches en « V » disposées sur un plan incliné passant sous le banc des joueurs pour ramener le boulet à son point de départ.
- Dalle en béton portant l’emplacement des quilles.
5 et 6. Deux des neuf quilles disposées sur la dalle. Quilles en bois avec cercle en fer à la base. Ici, M. Grégoire apporte d’utiles précisions : « Une quille mesure 30 cm de hauteur, elle se compose d’un cylindre de 15 cm puis part en cône sur 15 cm. Sur la jeu, la première quille a un diamètre de 12 à 14 cm, les deux suivantes (les dames) font 10 à 12 cm de diamètre et les autres 9 à 10, les deux quilles extérieures s’appellent les valets. Toutes sont façonnées dans du bouleau »
A noter, poursuit M. Mathelot, que le diamètre des circonférences marquées sur la dalle était légèrement supérieur à celui des bases des quilles, ce qui permettait un léger ajustement dans la position de celles-ci. le joueur pouvait demander à déplacer légèrement les quilles 5 ou 6 vers l’intérieur du jeu (Serrez li fotche à dreute ou à gauche) soit vers l’extérieur (Drôvî li fotche).
- Piste, en très fines cendres, ratissée très régulièrement dès que le besoin s’en faisait sentir. M. Grégoire quant à lui n’évoque pas une piste mais une planche « où l’on fait rouler le boulet et mesurant10 à 12 mètres de long sur 15 à 20 cm de large. »
- Planches enfoncées verticalement délimitant l’aire de jeu.
- Les horottes. La piste en cendrée ayant une forme trapézoïdale, les horottes étaient les deux évidements ainsi formés. Quand un boulet mal lancé finissait el horotte, il s’en allait lamentablement terminer sa course à côté de la dalle en béton. Le commentaire le plus expressif, autant que laconique, concernant le malheureux joueur était « Y l’a fè bèrwète».
- planche de départ (je suis quasiment certain, indique M. Mathelot, que cette planche portait un nom typiquement wallon mais pas moyen de m’en souvenir…) Quand le joueur lance li boulèt, celui-ci doit impérativement toucher la planche de départ avant de poursuivre sa course sur la piste en cendrées. Si le boulet commence directement sa course sans toucher la planche de départ, le joueur a fè hovlète et le coup est nul.
Il n’y a pas grand-chose à dire à propos du boulèt si ce n’est qu’il était en bois, mais j’ignore quelle essence il fallait utiliser. » M. Grégoire vient donc à son secours : « Le boulet est fait dans du hêtre ou du charme. Il a un diamètre de 18 à 20 cm et pèse 4 à 5 kg. Pour le tenir, il y a un trou où placer le pouce et une encoche pour glisser les quatre autres doigts. »
La semaine prochaine nous suivrons les explications de mes correspondants sur le déroulement des parties.
La petite Gazette du 1er septembre 2010
LE JEU DE QUILLES DANS NOS REGIONS
Comme promis, nous retrouvons les témoignages de MM. A. Mathelot, de Poulseur, et M. Grégoire, de Gouvy, qui évoquent pour nous le déroulement d’une partie de jeu de quilles.
Le premier raconte que « la partie pouvait accueillir un nombre illimité de joueurs. La mise de départ s’arrêtait de commun accord entre les joueurs, de 5 francs, ine pèce, à 10 ou 20 francs. Après dépôt des mises à même le sol, on commençait le premier tour. Quand chaque joueur avait tenté sa chance, deux cas de figure pouvaient se présenter. Soit un seul joueur avait obtenu un score supérieur à tous les autres, il empochait alors les mises et la partie était terminée (on pouvait en commencer une autre) ; soit plusieurs joueurs avaient atteint le même score supérieur à celui des autres, on disait alors que « li pârt èst bouf ». Alors recommençait un autre tour auquel participaient gratuitement les joueurs détenteurs du meilleur score au premier tour, mais tous les autres, s’ils voulaient continuer la partie, devaient doubler leur mise initiale. Il en allait de même jusqu’à ce qu’un joueur mette tout le monde d’accord en surclassant ses adversaires.
Avec 10 ou 15 joueurs, il n’était pas rare de voir les parties s’éterniser à force d’être « bouf »… il ne faut pas perdre de vue que, pour continuer la partie, les « perdants » devaient débourser des sommes de plus en plus importantes (de 5 francs au départ, ils misaient ensuite 10 francs, puis 20, 40 et ainsi de suite).
Un joueur pouvait néanmoins quitter la partie à tout moment, il arrêtait alors de miser mais perdait évidemment ce qu’il avait déjà déposé !
Au sujet des gains, j’ai conservé le souvenir d’une anecdote. Un samedi soir, mon père emporte finalement une partie qui avait été « bouf » je ne sais combien de fois ; il avait ainsi empoché un beau pactole. Une semaine plus tard, le dimanche, nous « remontions » fièrement au village, mon père avec un nouveau pardessus et moi, tout fier, dans mon nouveau paletot, un peu trop grand il est vrai.
Je ne sais plus dans quelles circonstances a disparu le jeu de quilles de Villers-le-Temple car il faut savoir qu’au-dessus du jeu de quilles se trouvait la salle de bal et, assez tôt, j’ai gravi l’escalier qui menait vers un autre monde… »
Monsieur Grégoire explique à son tour : « Les joueurs sont en nombre illimité et la mise va de 5 à 1000 francs, aujourd’hui c’est évidemment en euros. Ainsi s’il y a dix joueurs à 100F., il y a 1000F. sur la table. Tous jouent une fois et on retient le plus grand nombre de quilles tombées (il faut obligatoirement avoir la première). Si 5 joueurs ont eu 4 quilles, on dit qu’ils sont « barres » et ils peuvent jouer au deuxième tour. Si les autres veulent continuer la partie, ils doivent remettre de l’argent (la somme qu’il y a sur la table divisée par le nombre de barrants) ; ainsi dans l’exemple cité 1000F. que l’on divise par 5 soit 200F. et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul joueur. Le gagnant « lève » la part et donne un pourcentage de ses gains (généralement 5%) à celui qui tient la table et à celui qui relève les quilles et renvoie le boulet.
Dans certains villages, le dimanche de la kermesse, un jambon est joué. C’est un jambon à l’os fumé pesant 6 à 8Kg. Le responsable du jeu vend des cartes à 100F./pièce jusqu’à concurrence au moins du prix du jambon. Une carte donne droit, selon les villages, à un ou à deux coups de boulet. Au premier tour, il faut au moins 3 quilles pour être « barre » et recevoir une carte d’un autre jeu (pour ne pas mélanger le premier avec le deuxième tour). Le responsable distribue les cartes dans l’ordre suivant : cœur, carreau, trèfle, pique et, dans chaque série, as, roi, dame, etc. Ensuite, il appelle les joueurs par la dernière carte distribuée, donc le dernier « barrant » à jouer sera le détenteur de la carte « as de cœur ».
Aux tours suivants, les barres sont à ceux qui feront tomber le plus de quilles. Les tours s’enchaînent jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul joueur qui gagne le jambon et, généralement, qui paie un verre aux autres joueurs.
Ce dimanche 1er août, un jambon a été joué à la kermesse de Courtil-Bouvigny, lors d’un jeu à 9 quilles. Cette tradition est entretenue dans d’autres villages encore. »
Un immense merci pour ces témoignages précis. L’un des joueurs ou des spectateurs de ces jeux de quilles nous procurera-t-il des photos de ces rencontres ? Je l’espère vivement car je sais qu’elles intéresseraient bien des lecteurs.
La semaine prochaine, nous vous donnerons connaissance des souvenirs d’un autre lecteur encore.
La Petite Gazette du 8 septembre 2010
LES JEUX DE QUILLES DE NOS VILLAGES…
Je savais que ce sujet vous passionnerait et je ne suis pas déçu ! Aujourd’hui, je puis vous donner connaissance du contenu de l’intéressant envoi de M. Henri Preudhomme, de Neupré.
« En 1949, à Ivoz-Ramet, j’ai souvent participé à ce jeu comme releveur de quilles. On y jouait « à la partie » autorisée par la loi. Chaque joueur payait 5 francs pour participer. Le gagnant étant celui qui faisait tomber le plus de quilles. S’il y avait des ex aequo, la partie continuait jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul joueur qui empochait la mise.
Comme releveur, je notais sur un tableau les points des participants. Au gagnant, je notais le nombre de coups de boulet de la partie. Chaque gagnant devait me payer 25 centimes par coup de boulet joué. Cela se passait le samedi soir et le dimanche de 14 à 22 heures. Le samedi, je gagnais 250 à 300 francs et le dimanche de 400 à 500 francs. Un jour de fêt m’a même rapporté 750 francs. A Seraing, il y avait d’autres jeux de quilles sur lesquels on pariait sur un nombre impair de quilles que le joueur allait faire tomber. Ce genre de pari était interdit par la loi ! Des collègues de travail me racontaient qu’ils pouvaient perdre ou gagner 4000 à 5000 francs par soirée ! C’était presque un mois de salaire…
Le jeu de quilles, c’est une piste de 7m ; de long, 60 cm de large, pour arriver au carré des quilles à 90 cm ; Les quilles sont posées sur une tôle en forme de triangle. Au début de la piste, il y avait une table qui séparait la piste d’élan et sous laquelle les boulets étaient lancés vers les quilles.
L’argent devait être déposé sur la table, à la vue de tous les joueurs. La technique du bon joueur consistait à frapper entre les deux premières quilles qui constituaient ce qu’on appelait la fourche. A droite pour un droitier, à gauche pour un gaucher. Une quille mesurait 30 cm de haut avec un diamètre de plus ou moins 9 cm. Le boulet, quant à lui, avait un diamètre d’environ 22 cm et présentait trois trous de 30 à 50 mm de profondeur. »
J’espère toujours de tout cœur recevoir des photos montrant les joueurs en action.
La Petite Gazette du 22 septembre 2009
UN BIEN BELLE PHOTOGRAPHIE D’UN JEU DE QUILLES
Monsieur Lucien Leruth, un très fidèle lecteur de La Petite Gazette, a suivi un conseil que je vous répète souvent et a fouillé ses albums aux vieilles photos pour en extraire celle-ci.

« J’ai lu avec intérêt les articles relatifs au jeu de quilles et, dans l’album de vieilles photos hérité de mon oncle Arsène Leruth je trouve cette photo de 1916 montrant le passe-temps des habitants.
Au dos, j’y trouve la liste des noms des personnes photographiées, elles sont citées à droite de bas vers le haut: Victoire Schonne, Joseph Leruth, Nelly Collet, Paul Gilles, Arsène Leruth, Odon Hebrant, Jules Henkard, Henri Henrotin, Hervé Gaillard, Honoré Schonne, François Gilles, Marcel Gaillard (et des gamins). »
La Petite Gazette du 20 octobre 2010
LE JEU DE QUILLES A BOURDON
Monsieur Patrick Remy, de Jambes, me signale qu’il « possède aussi cette photo (NDLR il s’agit de la photo présentée il y a quelques semaines sous le titre « Une bien belle photo d’un jeu de quilles ») sur laquelle figure mon arrière-grand-père Honoré Schonne et sa soeur Victoire. Grâce à M. Leruth, je peux enfin mettre un nom sur chaque personnage présent. Je n’ai pas pensé à regarder cette photo de plus près lorsqu’un de vos lecteurs avait lancé une recherche sur les jeux de quilles. Ma grand-mère, Andrée Schonne confirme qu’il y avait bien un jeu à cet emplacement.
Ci-dessous la reproduction d’une carte postale figurant la même rue mais dans le sens « inverse ». »




 Elle s’inscrit dans le cadre de la journée mondiale du 21 février 2016 des langues menacée décrétée par l’Unesco.
Elle s’inscrit dans le cadre de la journée mondiale du 21 février 2016 des langues menacée décrétée par l’Unesco.



 Je me permets de vous adresser une photo de la gare de Marenne à Bourdon, où sa famille habitait, et puisqu’il en parle dans son article, une autre photo, celle du pignon de la maison de feu Christian Fautrez à Marche, passionné d’histoire de guerre, lequel y a fait peindre l’insigne de cette fameuse 84e division d’infanterie !
Je me permets de vous adresser une photo de la gare de Marenne à Bourdon, où sa famille habitait, et puisqu’il en parle dans son article, une autre photo, celle du pignon de la maison de feu Christian Fautrez à Marche, passionné d’histoire de guerre, lequel y a fait peindre l’insigne de cette fameuse 84e division d’infanterie ! 


 AVIS
AVIS